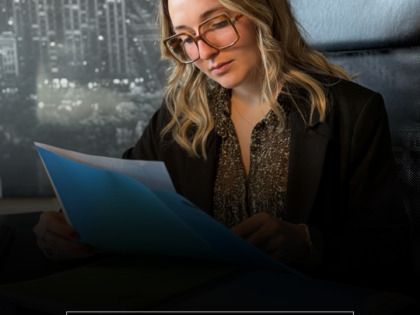La fraude au RIB falsifié à l’aune du droit des obligations. Par Olivier Collion, Avocat.
Article publié vendredi 14 mars 2025, par Olivier COLLION sur www.village-justice.com
A l’heure où piratages internet et fraudes de toutes sortes se multiplient, nombreux sont ceux qui se retrouvent victimes d’une escroquerie d’un nouveau genre : la réception d’un RIB falsifié, les amenant à payer une somme non pas à leur créancier, mais au bénéfice d’un compte bancaire frauduleux. Quelles sont les conséquences d’un tel paiement ?
La fraude au RIB falsifié à l’aune du droit des obligations :
« Qui paie mal, paie deux fois ».
Cet adage, familier à tous les juristes, implique que le débiteur qui paye à une personne qui n’est pas son créancier n’est pas libérée de sa dette. Il doit donc payer deux fois.
En effet, le Code civil prévoit en son article 1342-2 que : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ». Toutefois, le législateur soucieux de protéger le débiteur de bonne foi, a envisagé une exception à l’article suivant. Ainsi, l’article 1342-3 du Code civil prévoit que le paiement est valable lorsque le débiteur l’a effectué de bonne foi et à un créancier apparent. Il est donc fait ici application de la théorie de l’apparence.
Cette exception, en théorie limpide, se heurte néanmoins à un phénomène bien récent qui brouille la frontière entre le créancier considéré comme apparent et le faux créancier : la fraude au RIB.
La fraude au RIB est devenue aujourd’hui une manne financière prisée par de nombreux escrocs. Le mode opératoire de ces derniers est simple. Le créancier, souvent un prestataire de service, exécute son obligation, et envoie un mail contenant la facture ainsi que son RIB à son client pour recevoir paiement. L’escroc ayant préalablement piraté le courriel du créancier, prétexte dans la majeure partie des cas un changement de compte bancaire, pour envoyer un mail frauduleux au débiteur contenant son RIB. Le piège se referme ainsi sur le débiteur qui vire les fonds sur le compte bancaire ouvert par l’escroc. Le prestataire de service ne reçoit donc jamais le paiement de son débiteur, qui se prétend pourtant libéré de son obligation auprès de son créancier.
Dès lors, se pose la question suivante : le tiers escroc peut-il être qualifié de créancier apparent au titre de l’article 1342-3 du Code civil ?
Le phénomène étant en pleine expansion un certain nombre de cours d’appel ont déjà dû répondre à cette question sans qu’elle ne soit encore arrivée devant la Cour de cassation. Il convient aussi de remarquer que ce contentieux est souvent abordé sous le prisme du droit bancaire, même si un nombre substantiel de plaideurs appuient désormais leurs demandes en paiement sur le fondement du droit des obligations !
A l’étude de ces arrêts, les juges du fond semblent avoir pris le parti des créanciers victimes de fraude, en dépit des sommes souvent importantes engagées par les débiteurs.
En effet, dans un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de Montpellier, les juges du fond avaient ainsi considéré que le paiement qui est fait à un faux créancier n’est pas libératoire, car il n’est pas effectué auprès d’un créancier apparent, l’escroc n’ayant jamais été investi d’une quelconque possession de créance le débiteur ayant mal payé, il doit ainsi payer deux fois [1].
Pour considérer comme non libératoire le paiement, la Cour fait étonnement application de la condition prévue à l’ancien article 1240 du Code civil tenant à la possession de la créance. Il convient cependant de rappeler que cette condition n’est plus d’actualité puisque absente dans la rédaction du nouvel article 1342-3 du Code civil.
Cet arrêt va même plus loin et considère qu’on ne peut reprocher aucune faute civile au créancier victime de piratage, car l’utilisation d’une messagerie ordinaire comporte les mêmes risques que d’adresser une facture par la poste.
Dans un arrêt encore plus éloquent, et pour des faits analogues, une Cour d’appel avait conclu en ce que : « le déroulement des faits étant de nature à exclure toute croyance légitime pour le débiteur sur la provenance et l’authenticité des indication de paiement contradictoires reçues, le paiement n’est pas libératoire » [2].
Il convient de remarquer que ces décisions sont aussi fondées sur les négligences caractérisées des débiteurs, sciemment mises à profit par les escrocs.
En effet, il ressort de la majorité des faits d’espèce, que ces derniers commettent un nombre substantiel d’erreurs matérielles telles que des fautes de syntaxe ou d’orthographe, les escrocs étant souvent domiciliés à l’étranger. Leurs correspondances avec les débiteurs manquent ainsi de cohérence, ces derniers n’hésitant pas à inventer de fausses sociétés à l’étranger ou à introduire dans leurs manœuvres frauduleuses de faux affactureurs.
La jurisprudence met alors en exergue ces négligences pour fonder ses décisions.
Ainsi la Cour d’appel de Caen a constaté que le débiteur ne pouvait ignorer que le compte dont la référence commençait par les lettres ES et non FR était situé en Espagne et non en France, ce qui aurait dû conduire le solvens à de plus amples vérifications, et ce, alors même que celui-ci avait été destinataire de deux messages successifs comportant des coordonnées bancaires différentes [3].
Il a été ainsi considéré que ces éléments erronés auraient dû attirer l’attention des débiteurs et les conduire à vérifier les coordonnées bancaires auprès de leurs créanciers [4].
Si le créancier bénéficie d’une jurisprudence considérée comme favorable à son égard, il peut aussi se prévaloir du régime probatoire prévu à l’article 1353 du Code civil.
Aux termes de cette disposition, la charge de la preuve repose par principe sur le débiteur de l’obligation de paiement. Ce dernier aura donc beaucoup de mal à prouver qu’il s’est bien libéré de son obligation de paiement puisqu’il a payé à l’escroc.
Le créancier pourra quant à lui prouver qu’il n’a pas reçu le paiement en produisant par exemple une attestation de son expert-comptable [5]. La preuve pour le solvens est donc impossible à rapporter, et il y succombera.
Les différentes décisions des juges du fond semblent donc dessiner une tendance lourde favorable à l’accipiens, le paiement fait à un escroc étant rarement qualifié de libératoire, et cumulativement, la faute civile étant très souvent écartée pour celui qui s’est fait pirater.
Néanmoins, des décisions ont parfois pu infléchir cette inclination de la jurisprudence en faveur du créancier lésé. Celles-ci sont toutefois à nuancer, puisque marquées par des circonstances d’espèce étayant considérablement l’apparence de créancier véritable que possédait l’auteur de l’escroquerie.
La Cour d’appel de Nancy a ainsi pu juger comme libératoire, car de bonne foi, le paiement effectué par le créancier sur un RIB frauduleux, alors que le créancier avait refusé le paiement par chèque et l’avait averti lui envoyer un RIB par courriel [6].
Le phénomène étant en plein essor, nul doute que la Cour de cassation devra, dans un futur très proche, avoir à trancher sur cette passionnante question, qui pourrait donner un point final aux incertitudes des créanciers en difficulté suites aux défauts de paiement.
[1] CA Montpellier, 4ème ch., 26 septembre 2024, n°22/03450, voir aussi CA Agen, Chambre civile, 10 janvier 2024, n°22/00844.
[2] CA Agen, Chambre civile, 10 janvier 2024, n°22/00844.
[3] CA Caen, 25 mars 2021, n°20/01402.
[4] CA Paris, Pole 4, 10ème ch., 21 décembre 2023, n°20/16722, voir aussi TJ de Paris, 6ème chambre 1ère section, 2 juillet 2024, n°21/06308.
[5] CA Montpellier, 4ème ch., 26 septembre 2024, n°22/03450.
[6] CA Nancy, 1ère ch., 25 septembre 2023, n°22/02049.